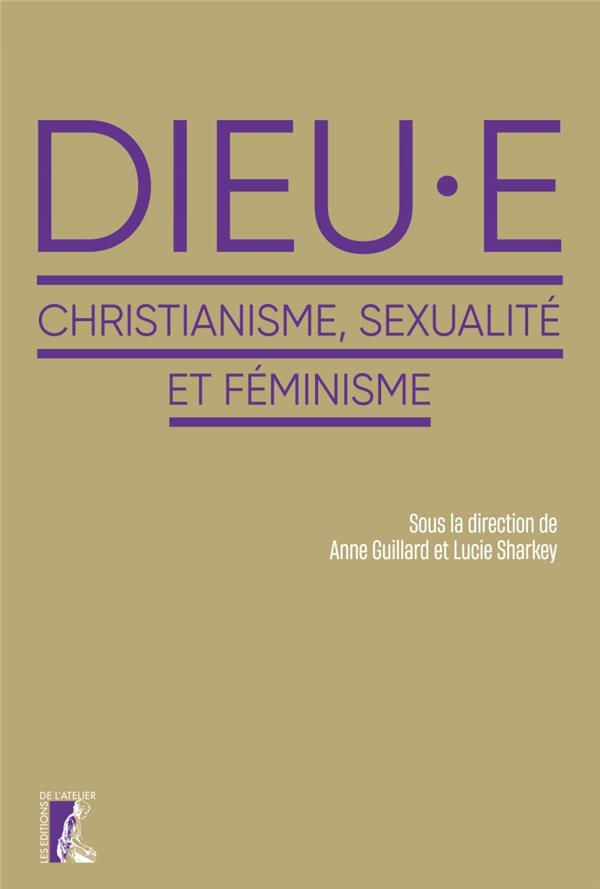Articles et chapitres d'ouvrages



« Penser l’enfantement dans une perspective émancipatrice ? Phénoménologie et psychanalyse »
13 août 2025
/ Clarisse PICARD


« Enjeux d’une philosophie de l’enfantement, de l’ontologie à l’éthique »
13 août 2025
/ Clarisse PICARD






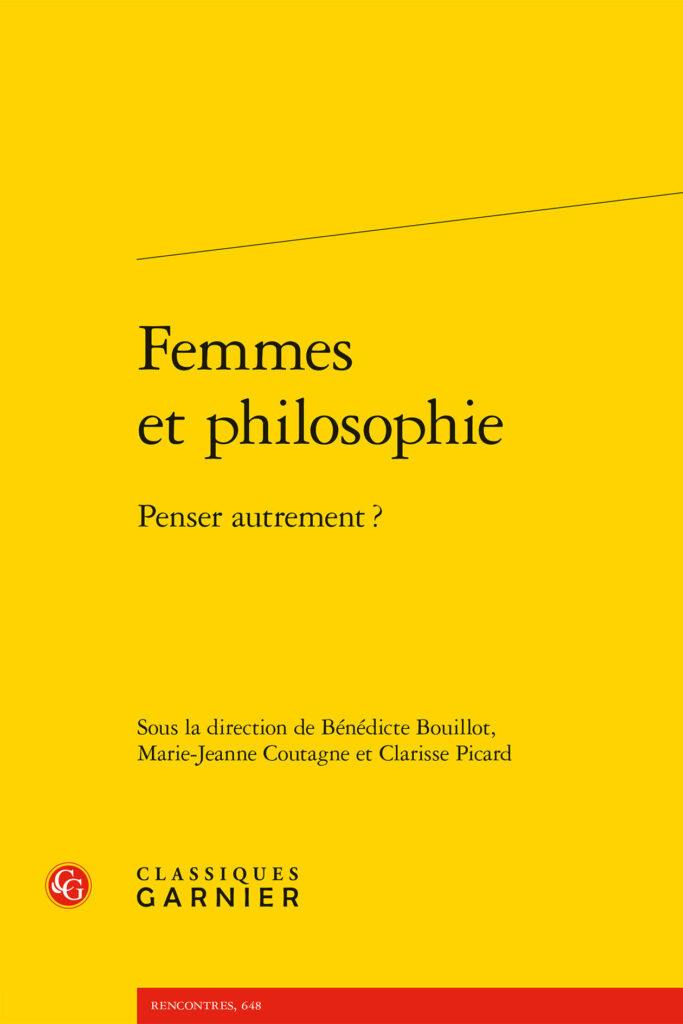
« Introduction. Femmes et philosophie. Penser autrement ? »
2 janvier 2025
/ Bénédicte BOUILLOT, Marie-Jeanne COUTAGNE et Clarisse PICARD
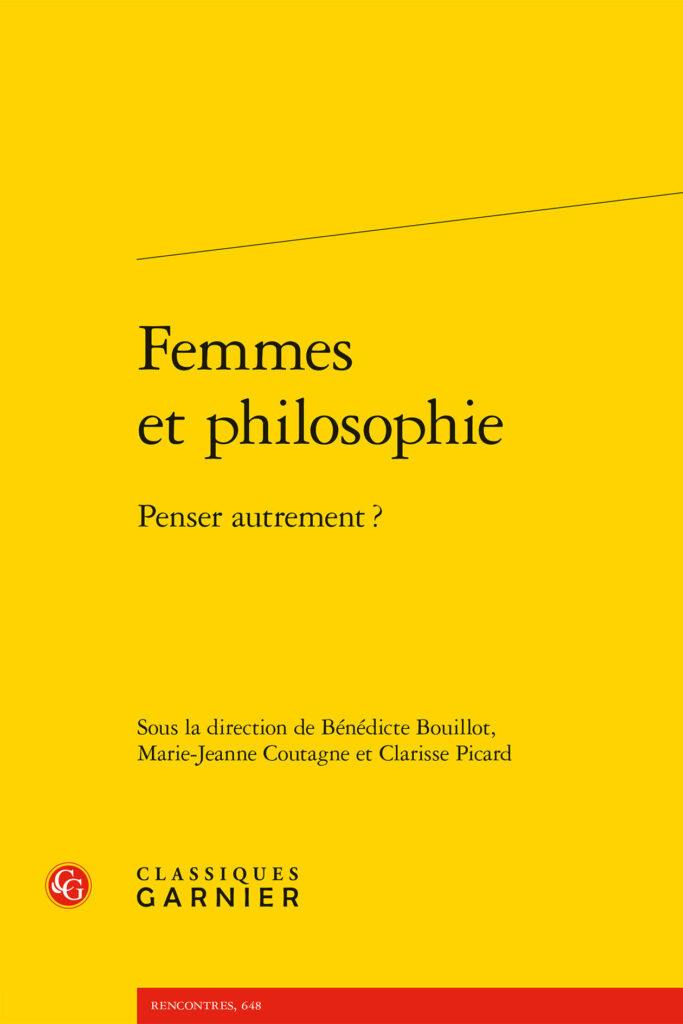
« Enjeux d’une philosophie de l’enfantement, de l’ontologie à l’éthique »
2 janvier 2025
/ Clarisse PICARD
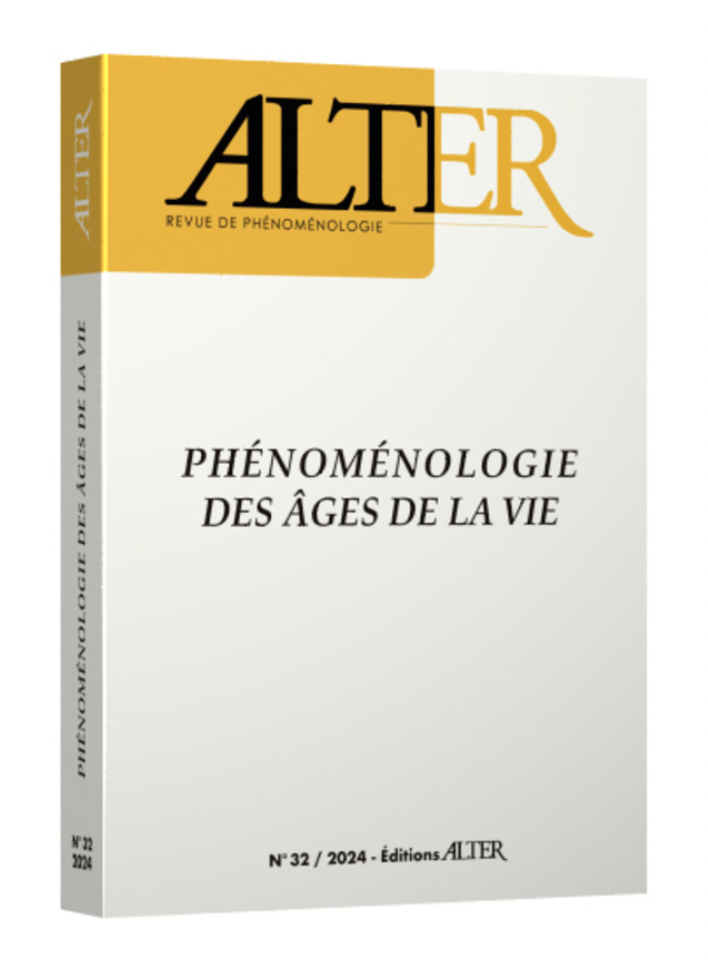
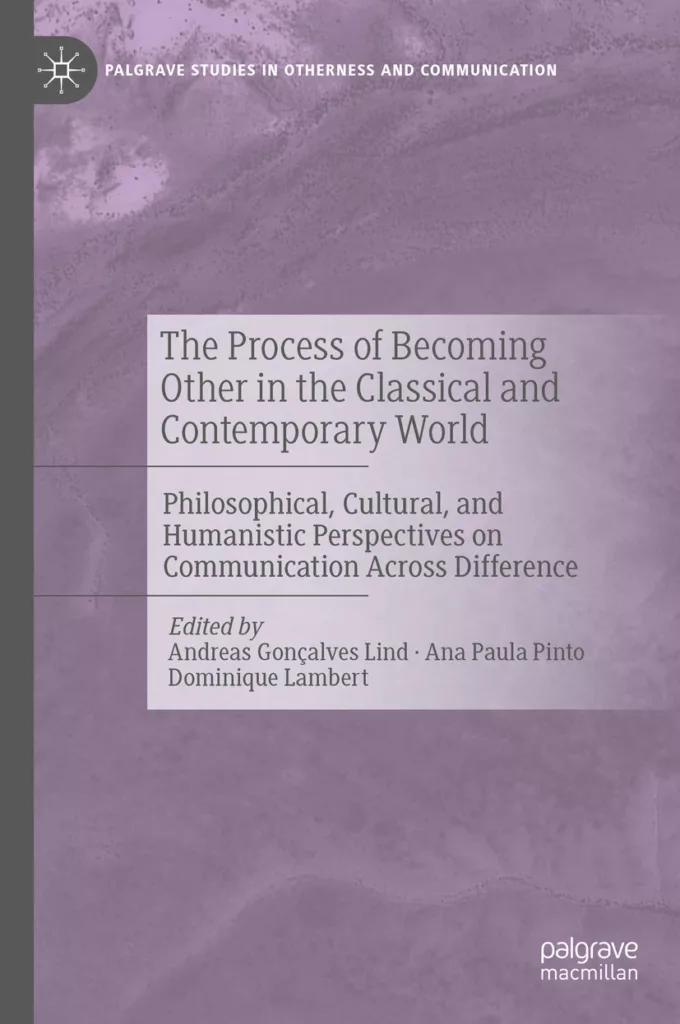
“Intersubjectivity and Otherness In the Experience of Childbirth: Psychoanalysis and Transcendental Phenomenology”
30 octobre 2024
/ Clarisse PICARD
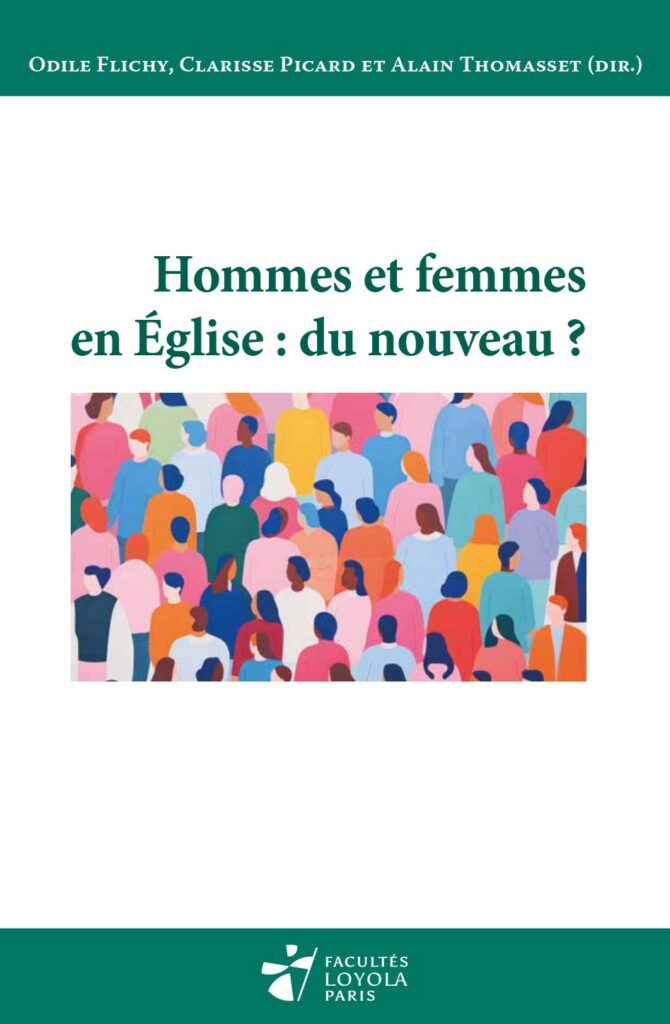
« Introduction. Penser à nouveau les relations entre hommes et femmes en Église »
1 mai 2024
/ Clarisse PICARD
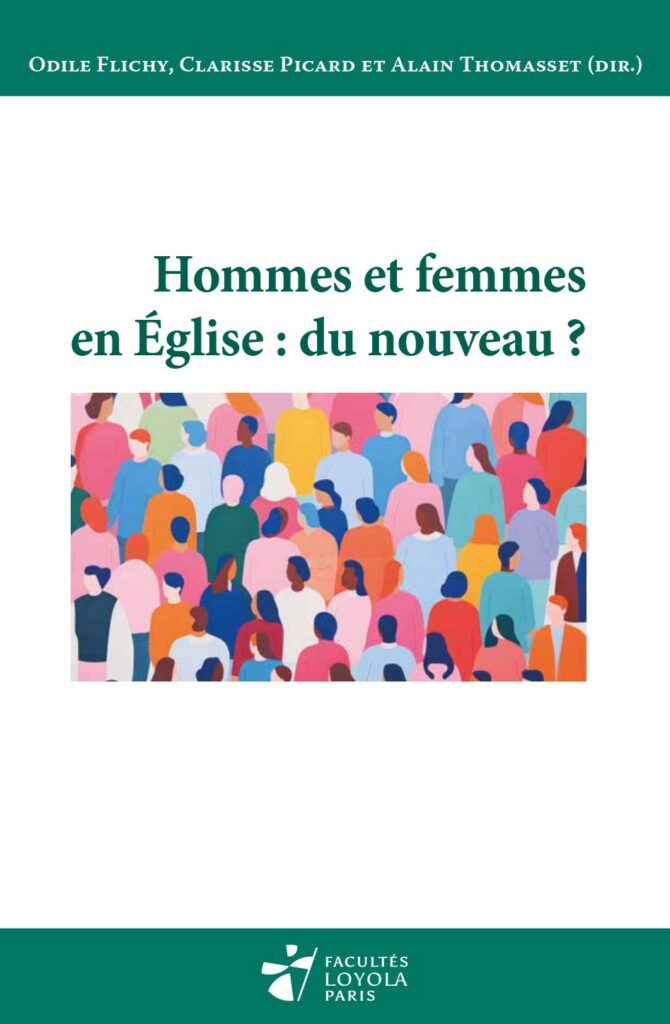
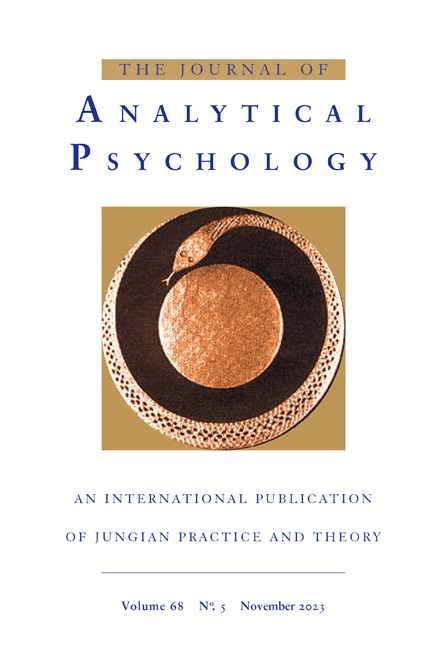
“Thinking Childbirth from an Emancipatory Perspective? Phenomenology and Psychoanalysis”
1 octobre 2023
/ Clarisse PICARD
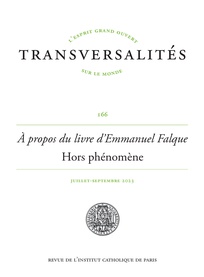
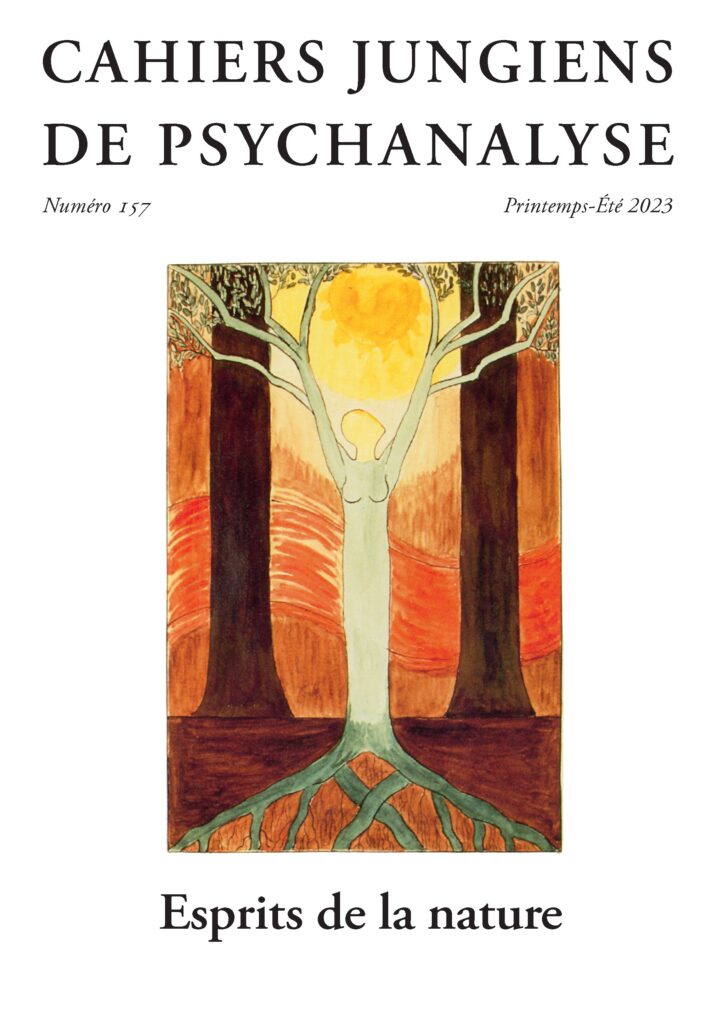
« Penser l’enfantement dans une perspective émancipatrice ? Phénoménologie et psychanalyse »
21 mars 2023
/ Clarisse PICARD